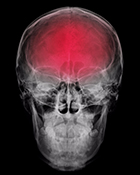L’absence de consensus scientifique n’empêchera plus l’indemnisation des victimes de vaccins défectueux.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 21 juin 2017 une décision importante en matière de vaccins défectueux (CJUE, 21 juin 2017, C621/15 N.W e.a/Sanofi Pasteur MSD e.a).
Les victimes d’un accident vaccinal qui cherchent à obtenir une indemnisation de leurs préjudices par les laboratoires pharmaceutiques, fabricants du produit, pourront voir leur procédure d’indemnisation aboutir.
Saisi par la Cour de Cassation via une question préjudicielle concernant la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux (Civ 1ère, 12 novembre 2015, n°14-18.118), les magistrats de Luxembourg ont estimé qu’ « en l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants »
Par cet arrêt, la Cour met fin à une tendance jurisprudentielle française qui refusait systématiquement l’indemnisation des victimes de vaccins défectueux en raison de l’incertitude scientifique qui règne en la matière.
Les requérants voyaient leur action échouée en raison de l’impossibilité scientifique de prouver de manière certaine le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage causé à la victime.
La Cour de Cassation se refusait à harmoniser la jurisprudence, et se retranchait derrière l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de causalité.
L’affaire de J.W illustre parfaitement le contentieux des vaccins contre l’hépatite B.
En l’espèce, J. W. s’est fait vacciner fin 1998 et début 1999 contre l’hépatite B. Dès la fin de l’été 1999, les premiers symptômes de la sclérose en plaque sont apparus. Elle a été diagnostiquée l’année suivante. Il a introduit en 2006 une action en justice pour faire reconnaitre que le vaccin produit par le laboratoire SANOFI PASTEUR était défectueux.
Cependant, il n’aura pas vu le terme de sa procédure – il est décédé en 2011.
La Cour d’appel de Paris, saisi de l’affaire, a considéré qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques. Elle a considéré que le lien de causalité n’était pas démontré et a rejeté le recours.
La CJUE justifie sa position en affirmant qu’exclure tout autre mode de preuve que la preuve scientifique aurait pour effet de rendre difficile voire impossible d’établir ou d’infirmer l’existence d’un lien de causalité et donc la responsabilité du producteur.
Il est vrai qu’un tel raisonnement revenait à être contre la ratio legis de la directive de 1985, autrement dit à ne pas protéger la sécurité et la santé des consommateurs et assurer une juste répartition des risques inhérents à la production technique moderne entre la victime et le producteur
Le raisonnement à tenir en la matière repose non plus sur une causalité scientifique certaine mais sur une causalité juridique probable résultant d’indices qui coïncident ou qui sont concomitants avec l'administration ou l'utilisation d'un médicament, lorsque la preuve scientifique, la preuve reine, ne peut être rapportée.
Désormais, le lien de causalité voire la défectuosité du vaccin lui-même pourra être établie par un recours à des indices tels que :
- La proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie
- l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée
- Le bon état de santé avant la vaccination
- l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations
Cependant la Cour laisse une marge d’appréciation aux juges nationaux en rappelant qu’il leur appartient d’apprécier si une telle preuve a ou non été apportée. Elle refuse d’ailleurs qu’un législateur national établisse une liste quelconque d’indices qui, s’ils existaient, suffiraient à établir le lien de causalité.
C’est donc toujours aux victimes d’apporter suffisamment d’éléments probants pour emporter la conviction du juge qui appréciera les dossiers au cas par cas.
Notons que ce recours aux indices graves, précis et concordants ne trouvera application que pour les vaccins non obligatoires pour qui la responsabilité du fait d’un produit défectueux s’applique. Pour les vaccins obligatoires, il conviendra de se reporter à la loi KOUCHNER de 2002.
Le droit à réparation des victimes par ricochet en cas d’infection nosocomiale
La loi du 4 mars 2002, dite loi KOUCHNER, est venue répondre aux attentes légitimes des victimes d’accidents médicaux non fautifs qui ne pouvaient, avant son adoption, voir leurs préjudices être indemnisés par le truchement de la responsabilité médicale.
Le Législateur de 2002 a donc institué le système d’indemnisation relevant de la solidarité nationale (art L1142-1 II csp) qui permet aux victimes directes ainsi qu’à leurs ayants droit d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels via l’ONIAM (art L1142-22 csp).
Cette indemnisation est conditionnée au décès de la victime directe, ce qui crée une différence notable avec la responsabilité civile. Très critiqué, en raison de la rupture d’égalité, pourtant garanti par la constitution, cette limitation a été approuvée par la Cour de Cassation qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (Civ 1ère QPC, 13 sept. 2011, n° 11-12.536). Le Conseil constitutionnel s’est finalement prononcé et a été du même avis que la Cour de Cassation (Décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016).
L’ONIAM refusait donc systématiquement d’indemniser les proches des victimes d’accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale lorsque la responsabilité d’un établissement de santé était susceptible d’être engagée, peu important la gravité du préjudice.
Cependant, aux termes de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices en cas d’infection nosocomiale entrainant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (ou Déficit Fonctionnel Permanent – DFP) de plus de 25%.
A la lecture de cet article, il apparait clairement que le Législateur n’a pas conditionné l’indemnisation des victimes par ricochet à la mort de la victime directe mais il a bel et bien permis l’indemnisation des victimes directes et de leurs ayants droits, même du vivant de la victime directe.
C’est du moins le sens qu’a retenu la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 février 2017 (Civ 1ère, 8 févr. 2017, n°15-19716) qui a jugé que l’épouse d’une victime directe d’une infection nosocomiale dont le taux de DFP est supérieur à 25%, doit voir son préjudice d’accompagnement indemnisé par l’ONIAM :
« Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique précitées, que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes ; que, lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM en leur lieu et place ; »
La Cour de Cassation consacre donc un véritable droit à réparation des proches des victimes d’infection nosocomiale dans les mêmes conditions qu’un établissement de soins.
Elle s’aligne sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait jugé quelques mois plus tôt dans le même sens :
« Considérant que s’il résulte des termes mêmes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, cité au point 2, que le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale qu’il prévoit ne peut bénéficier qu’à la victime du dommage corporel et, en cas de décès, à ses ayants droit, les dispositions citées au point 3 de l’article L. 1142-1-1 du même code instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en mettant à la charge de l’ONIAM le versement à l’épouse et aux enfants de M. A... B...d’indemnités réparant les préjudices ayant résulté pour eux de l’infection contractée par celui-ci au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand »
Restent encore des incertitudes dans la prise en charge de la réparation des préjudices des victimes par ricochet par la solidarité nationale : les accidents médicaux et les affections iatrogènes qui ne sont pas évoqués par l’article L1142-1-1 du code de la santé publique.
En l’état, seule une réponse jurisprudentielle pourrait permettre une importante et appréciable avancée.
L’obligation d’information du médecin sur les risques insuffisamment évalués d’une technique médicale récente.
Depuis la loi de 2002, le médecin doit recueillir le consentement éclairé du patient à l’acte médical, ce qui suppose une information préalable. Cette nécessité était déjà imposée par le code de déontologie des médecins (R4127-36 csp) et à l’article 16-3 du code Civil. La loi KOUCHNER a réaffirmé cette exigence (art L1111-4 du csp) en instituant le consentement à l’acte médical comme un préalable nécessaire à la licéité de l’acte médical pour le médecin, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Il existe pléthore d’exemples en jurisprudence.
Cette obligation d’information du médecin (R4127-35 et L1111-2 csp) lui impose d’informer son patient sur le diagnostic retenu, ainsi que sur le traitement envisagé et les risques inhérents au traitement ou à l’opération. Cette obligation ne cède que devant l’urgence, qui rend impossible la délivrance de l’information, ou lorsque le patient refuse d’être informé.
Après une incertitude en jurisprudence, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat (Civ 1ère, 7 oct. 1998, n° 97-10.267 ; CE 5 janv. 2000, n°181899, CE 5 janv. 2000, n°198530) ont retenu que l’information devait porter aussi bien sur les risques normalement prévisibles que sur les risques exceptionnels ; analyse que le Législateur a entériné avec l’article L1111-2 du code de la santé publique (l'information doit porter sur« les risques fréquents ou graves normalement prévisibles »).
Le Conseil D’Etat l’a rappelé récemment et a même précisé l’étendue de cette obligation d’information (CE 10 mai 2017, 397840)
En l’espèce, le CHU de NICE avait proposé à Monsieur B.A de bénéficier d’une technique opératoire nouvelle qui était censée permettre une récupération plus rapide, mais qui n'avait été appliquée que dans des cas très limités.
Le patient avait accepté l’opération à l’issue de laquelle il avait conservé des séquelles et dont il a demandé à être indemnisé.
La cour d’appel de Marseille avait, le 7 janvier 2016, retenue une faute des médecins en ce qu’ils n’avaient pas informé M.B.A des risques de la méthode utilisée et en ne lui présentant que les avantages de cette technique. Elle a mis à la charge de l'établissement la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, imputable à ce défaut d'information.
En cassation, le Conseil d'État entérine le raisonnement de la cour d’appel en relevant également l'existence d'un manquement à l’obligation d'information du patient de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique, il précise l’étendue du devoir d’information :
« que, lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en œuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques »
YOU HAVE RIGHTS, WE SHALL HELP YOU TO ASSERT THEM
In front of this procedural labyrinth, it is indispensable that a specialist advises to you and assists you in your steps.